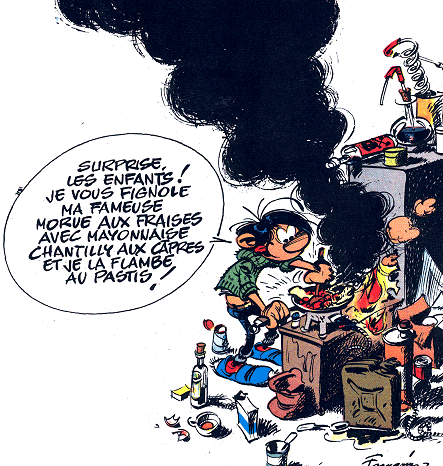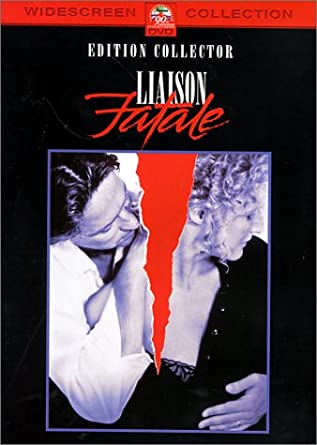Tout salarié se fait légitimement l’observation suivante lorsqu’il fait une bêtise en dehors du temps et du lieu de travail : « ce qui se passe chez moi, reste chez moi ».
Pourtant, il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut être sanctionné pour une faute commise dans le cadre de sa vie personnelle, dès lors que les faits se rattachent à sa vie professionnelle.
Une illustration de ce principe nous a été donnée en début d’année par la Cour de cassation, s’agissant d’un accident en état d’ébriété au volant d’un véhicule de fonction (Cass. soc. 19-1-2022 n° 20-19.742 F-D, Z. c/ Sté Manchettes résines réhabilitation de réseaux).
L’impétrant exerçait les fonctions de chef d’équipe dans le secteur du bâtiment, et c’est de retour d’un salon professionnel où il s’était rendu sur instruction de l’employeur que l’accident s’est produit. Le problème était d’autant plus sérieux que le salarié avait vraisemblablement fait une dégustation un peu approfondie de crus locaux en libre-service sur les stands, ce qu’ont constaté les forces de l’ordre sur le lieu de l’accident.
Licencié pour faute grave, le salarié a saisi le juge prud’homal pour contester la légitimité de la rupture (vous noterez mon goût prononcé pour les gens qui ne manquent pas d’air – quand bien même ils auraient soufflé dans le ballon – pour mes chroniques jurisprudentielles). Selon lui, les faits, commis en dehors du temps et du lieu de travail, relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient pas, par conséquent, justifier un licenciement disciplinaire.
La faute grave a pourtant été retenue par la Cour de cassation, approuvant l’analyse des juges du fond. Et pour ce faire, elle a évidemment considéré que les faits reprochés se rattachaient à sa vie professionnelle (pour un autre exemple, je recommande le passage à tabac d’un subordonné en dehors des heures de bureau : Cass. soc. 6-2-2002 no 99-45.418 F-D).
En l’espèce, facteur aggravant, les faits étaient susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l’employeur.
Trois éléments permettent donc aux juges de relier l’accident de la circulation reproché au salarié à sa vie professionnelle : le salarié était au volant de son véhicule de fonction, il rentrait d’un salon professionnel, et il s’était rendu à ce salon sur instruction de son employeur, pour les besoins de son activité professionnelle.
Note à l’attention des employeurs : la faute ce n’est pas d’avoir perdu son permis de conduire, c’est d’avoir provoqué un accident pouvant se rattacher à la vie professionnelle, nuance sur laquelle la lettre de rupture ne devra pas faire l’impasse.
Sébastien Bourdon