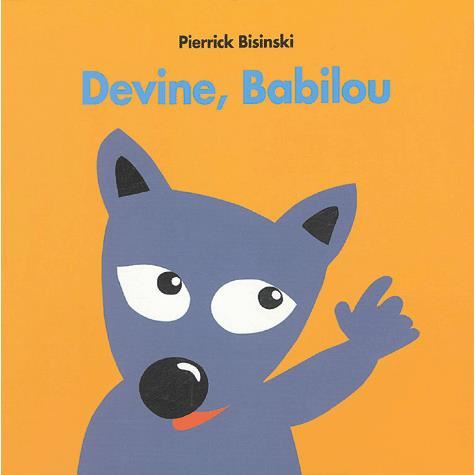Tout d’abord, rappelons que sauf exception, la conciliation constitue un préliminaire obligatoire dont l’absence entraîne une nullité d’ordre public de la procédure. Les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques, sauf lorsqu’il ordonne des mesures provisoires. Dans ce cadre, qu’est-ce qui peut être dit ou répété ultérieurement de ce qui s’est passé lors de cette première audience, en gardant à l’esprit que le but avoué de cette audience est de faire parvenir les parties à un accord amiable, évitant la poursuite de la procédure en Bureau de jugement. Il est dans ce cadre évident que la discrétion sur les pourparlers s’impose aux parties, ne serait-ce que pour garantir les bonnes conditions de la négociation où le secret et la discrétion s’imposent d’évidence.
Dans la première espèce dont il est ici question, il s’agissait de la contestation d’une rupture conventionnelle quelque peu forcée, car reposant en réalité sur des motifs économiques. Lors de l’audience de conciliation, l’employeur s’était exprimé en affirmant que la rupture du contrat de travail de la salariée se justifiait par l’acquisition d’un logiciel de comptabilité (propos d’ailleurs notés par un des conseillers présents, vraisemblablement dans le but d’apporter des éclaircissements lors de l’audience de plaidoirie, comme cela en est l’usage).
Nous avions évidemment repris cet aveu dans nos écritures, comme confirmant la tentative de fraude ayant entaché la procédure de rupture du contrat de travail par la voie conventionnelle plutôt que par celle du licenciement, au détriment des intérêts de la salariée concernée.
Dans ses écritures en réponse, arguant de ce passage de nos écritures, la société défenderesse venait affirmer que le fait d’évoquer ces propos justifierait la nullité de la procédure intentée, s’appuyant ainsi sur les dispositions cumulées des articles L 1411-1, R 1454-8 et R 1454-10 du Code du travail et 433 et 446 du Code de procédure civile.
Pour justifier sa position, la société défenderesse faisait état d’une décision émanant du Conseil de prud’hommes de Caen du 22 février 2013 dont une lecture attentive permettait de constater que ce qui était reproché à la demanderesse dans cette affaire, et qui avait justifié la nullité de la procédure, était d’avoir « fait expressément état des propositions » qui lui avaient été faites lors de l’audience de conciliation.
Cette jurisprudence précise donc en réalité bien ce qui ou ne peut pas se dire de ce qui s’est tenu lors de l’audience de conciliation, interdisant seulement l’évocation des échanges afférents à une issue transactionnelle. Ainsi, et en tout état de cause, cette décision ne s’appliquait pas aux faits de l’espèce, les propos évoqués dans nos écritures en demande étaient sans lien aucun avec d’éventuels pourparlers entre les parties en présence.
Cette position est d’ailleurs confirmée par les juridictions d’appel. Dans une décision du 12 septembre 2013, la Cour d’appel de Chambéry, en réponse à un moyen identique soulevé par la société intimée, statuait en ces termes sur l’exception de nullité soulevée (pièce n° 12) :
« Attendu que les éléments et propos invoqués par Monsieur Marc X… et qui auraient été tenus par la société C A D’A devant le bureau de conciliation ne concernent pas une ébauche de conciliation ou de proposition transactionnelle, mais sont seulement des moyens invoqués par l’employeur pour refuser toute conciliation, qu’il n’existe donc pas au cas d’espèce de violation du principe de confidentialité ».
Dans sa décision du 3 mars 2014, suivant ce raisonnement, le Conseil de prud’hommes de Poissy a donc écarté la demande de nullité en ces termes :
« Vu l’article 114 du Code de procédure civile : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi… »
Bien que l’article R 1454-8 du Code du travail dispose que les séances du bureau de conciliation ne sont pas publiques, aucun texte ne prévoit que les propos qui y sont échangés sont confidentiels. A défaut de conciliation, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notés au dossier ou au procès-verbal, de telle sorte qu’elles peuvent être considérées comme faisant partie de la mise en état de l’affaire.
En conséquence, dit mal fondée cette demande de nullité. »
Il n’échappera pas à la sagacité des lecteurs que le Conseil de prud’hommes ne semble ici retenir aucun propos tenu lors de la conciliation sous le sceau de la confidentialité, même d’éventuels échanges afférents à une solution amiable, et ce en contradiction avec les décisions précitées qui font expressément cette distinction.
Dans une autre espèce, c’est le cas inverse qui nous était soumis, le défenseur syndical de deux salariés ayant pris l’initiative singulière de révéler dans ses conclusions en demande des échanges afférents à des offres transactionnelles ayant pu être faites lors de l’audience de conciliation par l’employeur ou son représentant. Nous avons donc légitimement soulevé la nullité de la procédure intentée.
Le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges a tranché en ces termes le 26 janvier 2015 :
« Qu’en l’espèce Messieurs B et G ont fait expressément état des propositions qui leur on été faites par la défenderesse, lors de l’audience de Conciliation (…) ;
Que la demande de nullité soulevée in limine litis est recevable ;
Que l’inobservation des règles de la procédure, dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond et doit entraîner sa nullité ;
En conséquence, le Conseil de prud’hommes constate que Messieurs B et G n’ont pas observé les règles de la procédure ; qu’en conséquence la procédure est nulle. »
Ces décisions sont susceptibles d’appel, mais elles permettent tout de même de se faire une idée un peu plus précise de ce que l’on peut ou non rapporter de la teneur d’une audience de conciliation dans le cadre du bureau de jugement.
Surtout et en tout état de cause, au regard de la gravité de la sanction (nullité de la procédure), l’idée de faire état des pourparlers, quand bien même les parties ou leurs représentants ne seraient pas tenus par le secret professionnel, est évidemment à proscrire absolument.