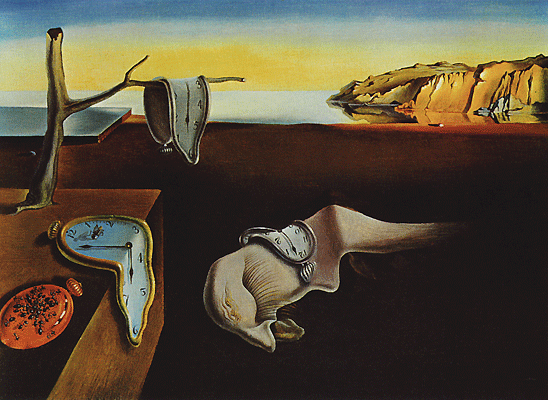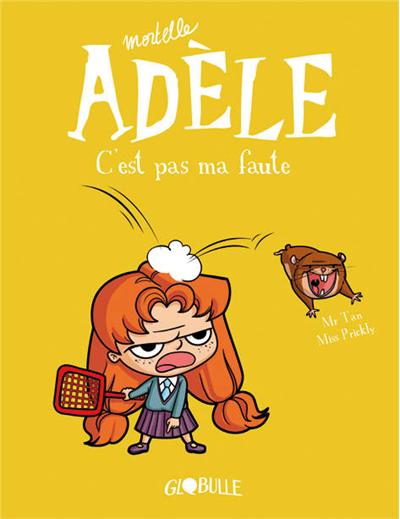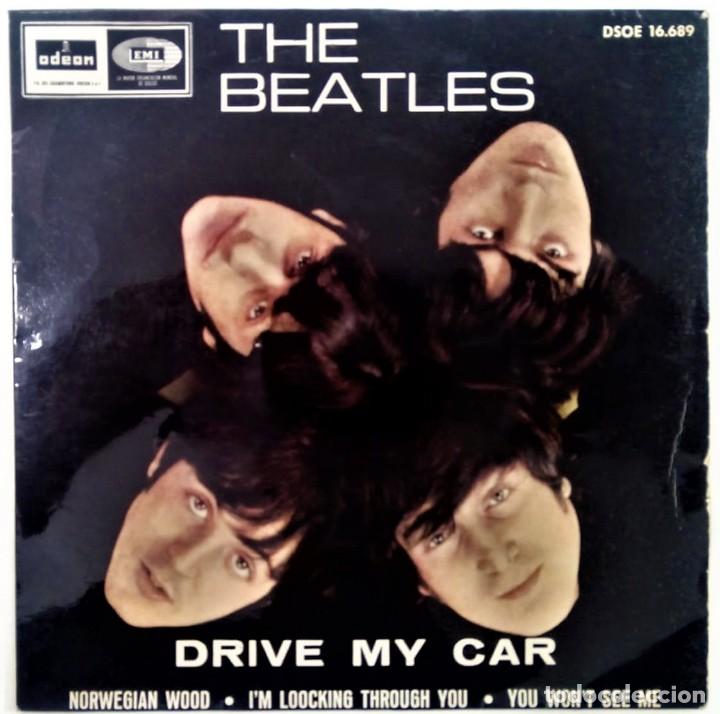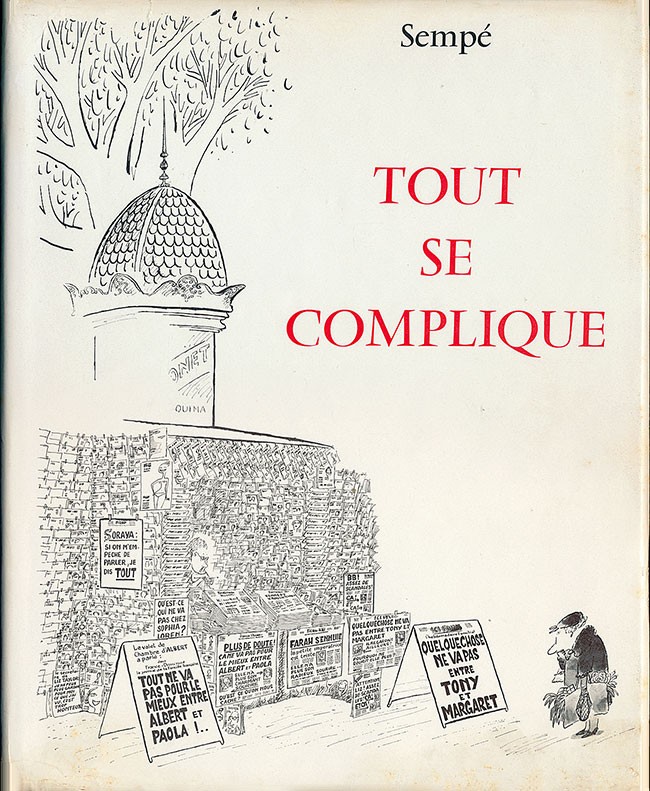S’il y a bien une décision qui était attendue, c’est celle que vient de rendre la Cour d’appel de Reims, à propos du barème « Macron » (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003, SCP BTSG c/ X).
En effet, première cour d’appel à statuer sur le sujet, elle l’a jugé conforme aux textes internationaux mais, car rien n’est jamais simple, elle a admis la possibilité pour le juge de ne pas l’appliquer.
Comment en arrive-t-on là, on va essayer de vous l’expliquer.
Pour mémoire, nombre de Conseils de prud’hommes ont à ce jour écarté l’applicabilité du barème, arguant de ce qu’il méconnaîtrait, notamment, les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention 158 de l’OIT reconnaissant aux travailleurs licenciés sans motifs valables le droit à une indemnité adéquate et appropriée (cf. nos chroniques précédentes).
La Cour de cassation a certes récemment rendu un avis (17-7-2019 no 19-70.010) leur donnant tort, mais cela n’a pas pour autant interrompu cette vague de contestation prud’homale, d’où l’intérêt évident de cette première décision d’appel (pour celle de Paris, il faudra attendre encore un peu, elle a été reportée au 30 octobre prochain).
Pour la cour d’appel de Reims, les articles 10 de la Convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne ont un effet direct horizontal, permettant de les invoquer dans l’enceinte des tribunaux français. Partant de cette possibilité, le juge rémois, analysant les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, conclut à leur conformité aux textes précités.
Tout d’abord, la Cour considère que le concept d’indemnité adéquate ou appropriée n’implique pas une réparation intégrale du préjudice, mais seulement une indemnisation d’un montant raisonnable au regard du dommage causé, et suffisante pour assurer l’effectivité de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse, ce qui ne serait pas intrinsèquement incompatible avec le concept de plafond.
Elle relève ensuite quand même que le dispositif prévu par le Code du travail serait de nature à porter atteinte au droit à une indemnisation adéquate et appropriée.
Mais, reprenant la maxime macronienne – « en même temps » – ces atteintes au droit à une indemnisation appropriée lui paraissent légitimes et proportionnées. Légitimes car nées d’une loi démocratiquement votée, et proportionnées car, contrairement au système italien par exemple, l’existence d’une fourchette laisse une latitude au juge dans sa décision.
Dès lors, pour la cour d’appel de Reims, « le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure (…) à la conventionnalité de celui-ci ».
Jusqu’ici tout va bien, mais le juge complique un peu le débat en considérant qu’il existe deux types de contrôle de conventionnalité d’une règle de droit interne au regard des normes européennes et internationales : le contrôle de conventionnalité de la règle de droit elle-même (contrôle « in abstracto ») et celui de son application dans les circonstances de l’espèce (contrôle « in concreto »).
Partant de là, la Cour juge ainsi que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ».
A suivre ce raisonnement, le juge saisi pourrait conserver la possibilité d’écarter l’applicabilité du barème, s’il le considère de nature à entraver une réparation adéquate. La recherche de proportionnalité doit se faire alors « in concreto ». Pour cela, il faudrait simplement que le salarié plaignant sollicite que soit faite cette recherche, le juge ne pouvant se saisir d’office de cette question.
En l’espèce, le salarié n’ayant pas demandé au juge un contrôle concret de son cas particulier mais seulement un contrôle abstrait de conventionnalité du barème, le jugé rémois a appliqué celui-ci.
Au regard de l’atmosphère actuelle dans le monde prud’homal, il faudra des avocats sacrément distraits pour oublier de former une telle demande.
Sébastien Bourdon